Au Théâtre de Carouge, Samuel Labarthe invite le public à le suivre sur les traces de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Rencontre
Dans l’adaptation théâtrale de L’Usage du monde, récit de voyage et d’amitié écrit par Nicolas Bouvier en 1963, l’acteur franco-suisse d’origine genevoise Samuel Labarthe livre, seul en scène, le récit sons et images de cette incroyable odyssée dans une Topolino poussive.

© Emilie Brouchon
En 1953, Nicolas Bouvier et son ami dessinateur Thierry Vernet partent, avec quatre mois d’argent de poche, pour un périple d’un an et demi à la rencontre de l’Altérité, tels des nomades, prenant le temps de découvrir, de rencontrer et de partager, au gré des rencontres, leur preux destrier roulant à 20km/h. Dix ans après leur périple, le récit de voyage n’était plus à la mode et Nicolas Bouvier dû publier à compte d’auteur son Usage du monde.
Sur scène, dans un dispositif épuré qui comporte un banc, deux tabourets et trois panneaux sur lesquels sont projetés des images et l’itinéraire parcouru, Samuel Labarthe transmet avec maestria l’écriture mordante et imagée de l’écrivain genevois, entraînant le public dans un voyage d’une heure et quart à travers les Balkans, l’Anatolie, l’Iran et l’Afghanistan grâce aux dessins de Thierry Vernet, à la musique ainsi qu’au souffle merveilleux de l’interprète.
En parcourant ces contrées lointaines dont certaines ne sont plus propices aux visiteurs étrangers de nos jours, l’écrivain genevois Nicolas Bouvier (1929-1998) n’imaginait peut-être pas que son récit de voyage deviendrait un ouvrage d’éludes dans les facultés de l’Hexagone. Au Poche Montparnasse, ce théâtre parisien qui est un repaire pour poètes-flibustiers, le comédien Samuel Labarthe a monté l’adaptation de L’Usage du monde avec Anne Rotenberg et Gérald Stehr, dans une mise en scène de Catherine Schaub.
Rencontre avec le comédien avant une répétition.
Nous sommes dans un fief théâtral très important pour vous, le Théâtre de Carouge, qui joue un rôle primordial dans votre parcours …
Effectivement, j’ai commencé ici. Mes premiers pas au théâtre ont eu lieu au collège et même au cycle d’orientation mais mes premiers pas professionnels au théâtre ont eu lieu au Théâtre de Carouge avec Georges Wod. C’est extraordinaire de pouvoir revenir ici jouer des années après. Je trouve que l’âme de ce théâtre existe encore. Jean Liermier, le directeur technique du projet et l’architecte ont fait un travail à trois qui est remarquable et ils ont su conserver l’âme du lieu. Ils ont été chercher dans divers théâtres en Europe ce qui leur plaisait. Aujourd’hui, ce théâtre est visité car c’est un modèle du genre avec un jeu de formes et de lumières. Je me réjouis tellement qu’il y a des théâtres qui se construisent encore de nos jours : c’est un exemple suisse car en France on ne construit plus de théâtre. À Lully, dans la commune de Bernex il y a un théâtre qui se construit qui s’appelle Le Cube.
Jusqu’au 23 février, le public peut découvrir ou redécouvrir L’Usage du monde, de Nicolas Bouvier, que vous présentez à nouveau dans la petite salle du Théâtre de Carouge après l’avoir présenté au Théâtre Le Poche Montparnasse à Paris puis au Théâtre de Carouge fin 2023 – début 24. Que représente ce texte pour vous ?
Des tas de choses ! Tout d’abord, un grand frère que je n’ai pas eu, voire un oncle puisque Nicolas Bouvier est plus âgé que moi. Cette vision du monde, cette curiosité pour d’autres pays lui est venu durant son enfance. Il était un peu solitaire, il a appris à lire avec sa gouvernante et il a commencé à lire les livres qui lui étaient autorisés, des récits de voyage comme Jules Verne, Stevenson ou les atlas de géographie.
Ce sont les livres que j’ai aussi lus enfant avec l’envie de m’enfuir de manière imaginaire, contrairement à Nicolas Bouvier qui pensait parcourir les pays qu’il voyait dans les livres. Nicolas Bouvier a nourri ce projet de voyage dès l’adolescence et a décidé de le faire avec son acolyte, Thierry Vernet, peintre et dessinateur, alors qu’ils avaient respectivement vingt-quatre et vingt-six ans. Ils ont réussi le pari fou de partir avec une Fiat Topolino qui peinait dans les montées et qu’il fallait pousser et sont parvenus à aller jusqu’à Ceylan. J’ai une fraternité avec Nicolas Bouvier et surtout avec son écriture qui est éblouissante. J’ai lu beaucoup de livres mais c’est le premier livre qui m’a fait crier pendant la lecture tellement mes émotions étaient fortes. Nicolas Bouvier a trouvé la langue secrète et trouvé les phrases pour exprimer la fascination devant certains paysages alors que d’autres personnes ne trouvent pas les mots. Je n’ai pas parcouru les pays que Nicolas Bouvier et Thierry Vernet ont traversés mais, pour me préparer à ce spectacle, je suis parti seul en randonnée dans le Jura en renonçant à mon confort, en affrontant les éléments dans l’immensité de la nature : cette expérience très forte m’a procuré une joie incroyable. Je voulais partager L’Usage du monde car, comme tous les artistes, j’ai envie de partager mes émerveillements. C’est pour cela que le spectacle dure depuis plus de deux-cents représentations, ce qui me réjouit car Nicolas Bouvier est très connu en Suisse mais en France, il a mis beaucoup de temps à se faire connaître ; on commence à l’étudier en faculté, en filière de philosophie et littérature. Je souffre encore de voir, dans certaines librairies françaises, Nicolas Bouvier placé dans les rayons voyages.
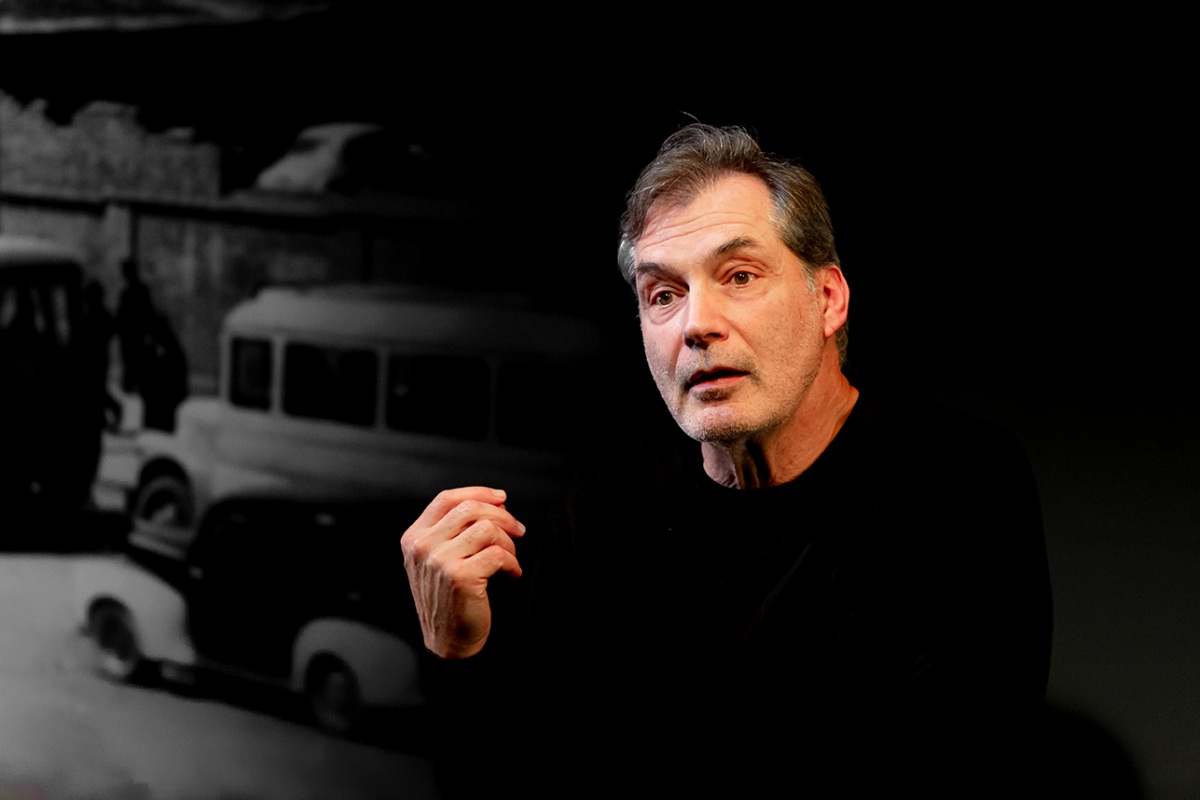
© Emilie Brouchon
À travers son langage très mordant, très expressif, il y a à la fois le voyage extérieur géographique mais aussi le voyage intérieur …
Vous avez raison, le voyage intérieur est très important. Nicolas Bouvier a écrit des phrases extraordinaires :
« On croit qu’on va faire un voyage mais c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. »
Dans l’adaptation que j’ai faite avec Anne Rotenberg et Gérald Stehr, dans une mise en scène de Catherine Schaub, il fallait réussir à transcrire le texte de Nicolas Bouvier pour la scène car c’est un texte très littéraire. Il y avait le danger d’être trop illustratif avec une langue qui n’est là que pour évoquer. Le dispositif scénique présente des photographies du voyage qu’ils ont fait, des musiques que Nicolas Bouvier a enregistrées avec son Nagra ainsi que les dessins de Thierry Vernet auxquels je tenais beaucoup. Ce voyage, ils l’ont fait et écrit à deux. J’avais besoin de présenter ce livre imagé mais aussi ce livre complet, presque un livre-monde qu’ils voulaient faire à deux sans tomber dans l’illustration, il fallait rester avec cette évocation du voyage. Je me rends compte que les spectatrices et les spectateurs aiment qu’on leur raconte une histoire mais aussi qu’on les emmène en voyage. L’Usage du monde est un moyen de s’échapper quand on ne peut pas voyager. Ce livre nourrit mon amour absolu pour la langue française, que m’a transmis mon propre père et que je transmets à mes quatre enfants.
L’an dernier, Catherine Schaub nous disait qu’elle souhaitait que ce spectacle donne envie au public de lire ou relire L’Usage du monde. Un souhait que vous nourrissez aussi ?
Je suis très utopiste mais comme la Suisse est le pays de l’utopie – la Croix Rouge était un projet merveilleux qui a vu le jour – j’aurais aimé créer avec ce spectacle une caravane humanitaire qui passe par toutes les étapes du voyage de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet mais aujourd’hui, certains pays ne sont pas envisageables. Je suis convaincu que les gens qui habitent dans ces pays sont les mêmes personnes que Bouvier et Vernet ont rencontrées. Ce sont des poignées de personnes qui changent les choses et qui font peur, ce n’est pas la majorité. Les politiques aujourd’hui surfent sur cette peur que l’on a des autres et celui qui est diabolisé par certains discours n’a rien de diabolique en réalité. Toutes les personnes qui sont parties dans ces pays nous parlent de leur hospitalité et comment ils accueillent les gens à bras ouverts. Regardez comment nous, nous accueillons les migrants alors que Genève est une ville de migrants, une ville cosmopolite qui s’est construite avec les migrants. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet ont pu traverser en toute quiétude l’Iran, l’Afghanistan.
Quel regard posez-vous sur ces deux pays avec ce qui s’y passe aujourd’hui ?
Je pourrai pleurer en pensant à ce qui est fait faire aujourd’hui aux femmes en Iran et par les Talibans en Afghanistan. Je ne comprends pas pourquoi on peut arriver à une telle barbarie car c’est se nier soi-même que de faire de telles choses aux femmes. L’Iran, qui a connu l’occidentalisme dans les années 50, n’imposait pas le voile aux femmes qui étaient habillées à l’occidentale. C’était aussi le cas des femmes afghanes pendant le royaume d’Afghanistan.
Je songe au documentaire Nomad’ Land (2008), du Valaisan Gaël Métroz qui est parti sur les traces de Nicolas Bouvier cinquante ans après lui et qui montre qu’on ne peut plus aller dans les mêmes endroits. Quand il arrive au Pakistan dans la ville de Quetta, c’est une catastrophe puis il arrive à la frontière pakistano-afghane, où les derniers trois mille païens Kalash vivent encerclés par la communauté musulmane et des réfugiés afghans, une contrée où les femmes ont les mêmes droits que les hommes et ne sont pas voilées. Les Talibans sont encore une poignée de gens qui imposent leurs lois, leurs principes juste pour régner, avoir le pouvoir. L’Afghanistan est un paradis perdu.
Dans L’Usage du monde, vous avez opté pour une mise en scène très épurée, comportant un banc, deux tabourets et trois panneaux sur lesquels sont projetés des images ainsi que des cartes où le public peut suivre le périple effectué par Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. L’épure scénique vise à mettre en lumière votre jeu et la richesse du texte, des images et des dessins ?
La sobriété de la mise en scène met en relief ces éléments car je suis juste un passeur, je n’ai pas l’impression de jouer quoi que ce soit. Je partage les images, les dessins, les musiques que les deux amis ont ramenés de leur odyssée. Ce n’est pas mon écriture, je ne fais que transmettre les mots de Nicolas Bouvier. Le spectacle permet de redécouvrir le texte pour beaucoup de personnes qui ont du mal à le lire; c’est un texte dense qui représente un récit de voyage avec beaucoup d’anecdotes, sur le voyage bien sûr mais aussi sur l’amitié avec beaucoup d’humour. Dans les Balkans, ils partent à la rencontre de la musique tzigane et ils remontent jusqu’au Penjab, aux origines indo-européennes de cette musique. Peut-être que les gens sortent du spectacle et vont acheter le livre, le lire et faire confiance à l’altérité.
La musique est un protagoniste à part entière ; pouvez-vous nous parler des extraits musicaux ?
Je voulais garder la structure du voyage, l’amitié, les mots et la musique comme film conducteur. Certains extraits comme la clarinette persane, les chants bulgares, la musique tzigane sont des morceaux de musique que Nicolas Bouvier a enregistrés. Nicolas Bouvier a la même force que Kessel, Saint-Exupéry; ce sont des personnes qui sont dans la fraternité. L’ingénieur polonais Stefan Kudelski, qui habitait à Genève à l’époque, a donné à Bouvier un Nagra, ce petit appareil enregistreur portatif. Il est parti avec un prototype à piles et à batterie et un microphone ; il s’est amusé à enregistrer des sons jusqu’au Japon. Pour le reste des extraits musicaux, j’ai été chercher la Fête des couleurs en Inde, une musique traditionnelle du Kurdistan et le chant magnifique de cette femme arménienne pour illustrer le voyage.
Les écrivaines voyageuses et écrivains voyageurs semblent une spécifié helvétique. On songe à Ella Maillart, Isabelle Eberhardt Anne-Marie Schwarzenbach. Le fait que la Suisse est petit pays au milieu des montagnes incite-t-il les personnes à partir à la rencontre d’autres cultures, d’autres pays, d’autres altérités ?
Vous avez raison ! Je me suis souvent posé la question. Ella Maillart était avant tout navigatrice avec son alter ego, Hermine de Saussure, dite Miette, et qui était la mère de Delphine Seyrig, ce que l’on sait moins. Habiter un petit pays au centre de l’Europe, au cœur des montagnes, sans accès à la mer, donne peut-être envie d’aller voir ailleurs. Cette situation force peut-être même la curiosité, le fait d’avoir ce paravent – les montagnes – entre le monde et soi. C’est un tout petit pays dont seulement le tiers est habité.

© Emilie Brouchon
Vous faites revivre sur scène le comparse de Nicolas Bouvier, Thierry Vernet, grâce à la voix de votre fils, Alexandre Labarthe, qui aussi comédien …
Thierry Vernet est quelqu’un qui me touche énormément par sa sensibilité. Il était le contraire de Nicolas Bouvier qui aimait beaucoup parler, qui était très extraverti. Quand il prenait la parole, il la gardait et c’est très bien car il disait des choses très intéressantes.Thierry Vernet était beaucoup plus effacé, discret, introverti. Il a gardé sa ligne jusqu’au bout – cette façon de regarder le monde, d’être un admirateur, un poète sans imposer quoi que ce soit. Ses dessins sont extraordinaires, c’était un amoureux de la lumière et qui voulait la reproduire comme tous les peintres. Il y a quelques années, pendant la pandémie, on a organisé une rétrospective de ses dessins et de ses peintures dans sa maison natale, à l’Espace Muraille, et qui a eu un très joli succès. Thierry Vernet n’a pas eu la notoriété, certes tardive, que Nicolas Bouvier a eue. Ce regard amical, ce regard tendre sur le monde, qu’il a partagé avec Nicolas à qui il a appris à regarder les nuances. Le fait de voyager avec une peinture nous amène à regarder différemment le monde. C’est un prisme qu’on devrait peut-être tous avoir.
Ils cheminaient paisiblement, à petite allure, ce qui est la seule façon de regarder le monde. Quand ils entament leur voyage, le monde est vaste, sans limite sans fin. Aujourd’hui, on a l’impression que tout est cartographié sur notre téléphone et qu’on a été partout. Ce qui est merveilleux, c’est de partir de façon nomade. On est toujours surpris par le voyage. Si on imagine un monde où il n’y aurait pas eu de sédentarité, il n’y aurait que des tribus nomades qui se croiseraient, ce serait extraordinaire. Il n’y aurait plus de races, que des mélanges. Ce serait peut-être une solution à certains problèmes actuels.
D’ailleurs, le théâtre c’est partir à la rencontre de l’autre, il n’y a pas de frontières. Mais, malheureusement, les dogmes et les radicalismes religieux restent des problèmes. C’est quand même surprenant que la religion qui prône la tolérance, la fraternité soit la cause des plus grands massacres qu’il y a eu jusqu’à présent.
Cependant, face à de tels extrémismes, il y a un remède très efficace comme le rappelle votre spectacle : la poésie. Dans le spectacle, vous relatez que Nicolas Bouvier et Thierry Vernet ont écrit des vers du poète iranien, Hâfiz, de Shiraz, des vers qui leur servaient de sésame durant leur voyage …
Le mausolée de Hâfiz à Shiraz est encore fréquemment visité par les jeunes fiancés qui veulent avoir la bénédiction et la protection de Hâfiz pour leur mariage. La culture persane est tellement extraordinaire et la poésie est tellement présente en Iran. N’importe quelle personne en Iran peut déclamer des vers de poésie. L’Iran est une petite enclave qui a résisté à la langue arabe. La poésie est là comme moyen de résistance et comme un moyen d’existence absolue. Aujourd’hui, il y a encore des poètes qui sont emprisonnés, interdits de séjour.
Comment vivez-vous votre retour à Genève, dans le théâtre où tout a commencé ?
Je suis content de revenir jouer à Genève car il y a un côté bon enfant, un enthousiasme et une curiosité, avec un regard neuf sur les choses. À Paris, c’est plus compliqué car il y a tellement d’offres que le public devient blasé. Je suis vraiment heureux de pouvoir présenter ce spectacle d’un livre qui m’a accompagné pendant de nombreuses années. Au Théâtre Le Poche Montparnasse, on a d’abord joué dans la salle en bas qui ne pouvait accueillir que quatre-vingts personnes. la forme initiale était donc un récit pendant une heure et quart où j’étais assis sur un banc sans bouger. C’est d’ailleurs le dernier spectacle que Philippe Tesson, le directeur du théâtre à l’époque, a vu. Dans la petite salle du Théâtre de Carouge, il y a un cadre de scène, un côté cinémascope, avec ses trois panneaux qui donnent sur l’infini et qui donnent cette impression d’espace. Il a eu un travail d’adaptation entre les diverses salles et le travail que l’on a fait l’année passée à Carouge nous a permis de le reprendre au Poche dans la grande salle dans une mise en scène où je pouvais bouger. C’est une incroyable alchimie : on a d’abord un livre sur sa table de chevet et cela devient un spectacle qui rencontre les gens.
Vous êtes connu du jeune public pour avoir prêté votre voix à George Clooney et une fois à Javier Bardem; vous incarnez l’inspecteur Swan Lawrence dans Les Petits meurtres d’Agatha Christie. Votre cœur balance-t-il entre le théâtre, le cinéma et le petit écran ?
Les Petits meurtres d’Agatha Christie ont été une très belle aventure. Et cela m’a permis de rajeunir mon public, en particulier des jeunes adolescents qui me disent qu’ils me connaissent depuis qu’ils sont tout petits. On avait des scénaristes qui nous écrivaient des choses sur mesure, des scénarios très ludiques. Dans ce paysage d’enquête policière, on était les seuls à être en costume et avoir ce côté Tintin bon enfant. On était à la lisière entre OSS 117, James Bond, ou Hitchcock avec La mort aux trousses (1959) et l’esthétique des années 60 qui nous a accompagnés. J’ai toujours été attiré par l’humour pince-sans-rire et l’imagerie des années 1960, si jolie et glamour. On a fait vingt-sept épisodes, c’étaient de vrais films de nonante minutes. On est partis en plein succès.
Mais j’adore la scène, le contact qu’on a avec le public, le fait de remettre son travail sur l’établi tous les soirs et d’aller chercher de nouvelles choses à chaque représentation pour encore améliorer le spectacle. Ce partage-là procure des bonheurs magnifiques que l’on n’a pas à l’écran. Le cinéma procure d’autres défis mais c’est sur les planches que je me sens le mieux. Cela peut être des frustrations comme des souffrances quand cela se passe pas comme on le souhaitait mais il y a aussi des bonheurs magnifiques de jouer sur scène. La scène est un révélateur comme une photographie. C’est Michel Bouquet qui disait : « Quand on entre en scène, on a tous les personnages qu’on a travaillés qui entrent en scène avec nous. Ce sont tous les personnages que vous avez travaillés jusqu’à présent qui donnent cette épaisseur, cette présence, ce poids sur scène. »
Firouz E. Pillet
© j:mag Tous droits réservés