Rencontre avec Douglas Beer, réalisateur de L’instant infini
Arrivant dans la région genevoise – on aperçoit le Salève au loin -, un couple de jeunes Français tombent en panne à quelques kilomètres dont la maison qu’ils ont loué. Accueillis par le propriétaire de la demeure, Philippe Miserez (Mathieu Chardet), le couple semble, a priori, comme tous les couples. Accablée par la culpabilité depuis la mort de sa fillette, Marie (Jennifer Rihouey) s’adonne à l’auto-érotisme pour cesser de constamment revivre le terrible accident. Devenu distant, son mari, Léonard (Damien Dorsaz) lui suggère de tirer profit de son addiction en devenant cam-girl. D’abord horrifiée par ce qu’elle juge être de la prostitution, Marie bientôt cède pour satisfaire celui qu’elle pense avoir perdu.
Le sujet du film laisse perplexe : un couple face au deuil, un mari qui délaisse sa femme qui ne voit comme seule issue l’onanisme. Les notes d’intention du réalisateur semblent claires à ce propos :
Le problème de Marie est son incapacité de faire le deuil de son enfant à cause de son énorme culpabilité. Elle se réfugie dans la masturbation compulsive pour oublier – même pour de brefs moments – l’instant de l’accident fatal.
Douglas Beer a voulu faire un panel exhaustif des femmes d’aujourd’hui à travers le personnage de Marie :
Comment les femmes peuvent-elles faire face aujourd’hui à ces différentes représentations que la société et les médias véhiculent trop souvent d’elles? est une des questions que je souhaite soulever dans L’instant infini.
Au casting du film on retrouve aussi Maria Mettral dans le rôle de Coolcam.
Douglas Beer a essuyé le refus de l’Office fédéral de la Culture et a dû assumé seul le financement de ce premier long métrage en hypothéquant sa maison. Vu le peu de moyens, la photographie s’en ressent et les scènes intérieures semblent particulièrement mal éclairées.
Si le film a enthousiasmé les journalistes masculins, il a laissé indifférentes, voire dépitées leurs collègues féminines. Sans doute un question de perception liée au genre. Afin de comprendre les motivations du cinéaste, nous avons rencontré Douglas Beer dans ses bureaux, dans la Maison des Artisans dans le vieux Carouge, proche de Genève. Dans un long entretien dense et varié, nous avons posé moult questions au cinéaste mais surtout à l’artiste plasticien qui se réjouit que son premier long métrage ait remporté le Prix d’excellence des IndieFEST Awards, compétition mondiale avant-gardiste à La Jolla, en Californie.
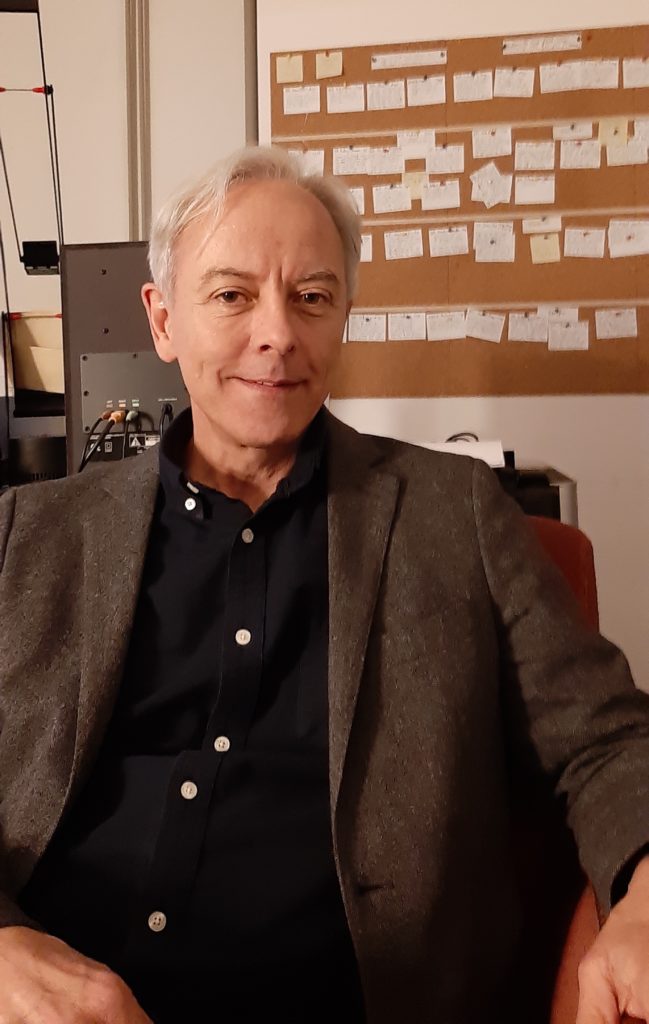
© Firouz Pillet
Né à Alger, Douglas Beer, fruit de la rencontre d’une mère anglaise et d’un père suisse, a vécu dans divers pays, dont l’Argentine, en fonction des postes occupés par son père, prospecteur dans l’industrie pétrolière. Il porte plusieurs casquettes : écrivain, enseignant de vidéo au Centre de formation professionnelle Arts, dans le quartier de Saint-Gervais, artiste plasticien. A ce propos, Douglas Beer se rappelle avec une joie tangible qui fait scintiller ses yeux que la même semaine où il a essuyé le refus de Berne pour le financement de son film, il a été sélectionné par l’Office fédéral des constructions pour élaborer un projet à la douane de Bardonnex :
j’ai réalisé une allée de vingt-six drapeaux colorés qui permettent d’élaborer tous les drapeaux du monde.
Pour son prochain film – dont les nombreux post-it collés sur un immense tableau derrière l’artiste augure du scénario en cours de rédaction – Douglas Beer repartira au Etats-Unis, un pays qu’il connaît bien pour y avoir et étudié et séjourné. En effet, Douglas Beer a étudié auprès du Whitney Independent Study Program de New York après avoir étudié à l’HEAD (Haute Ecole d’art et de design de Genève, ex-ESAV) et du Whitney Independent Study Program de New York.
Propos recueillis par Firouz E. Pillet
© j:mag Tous droits réservés