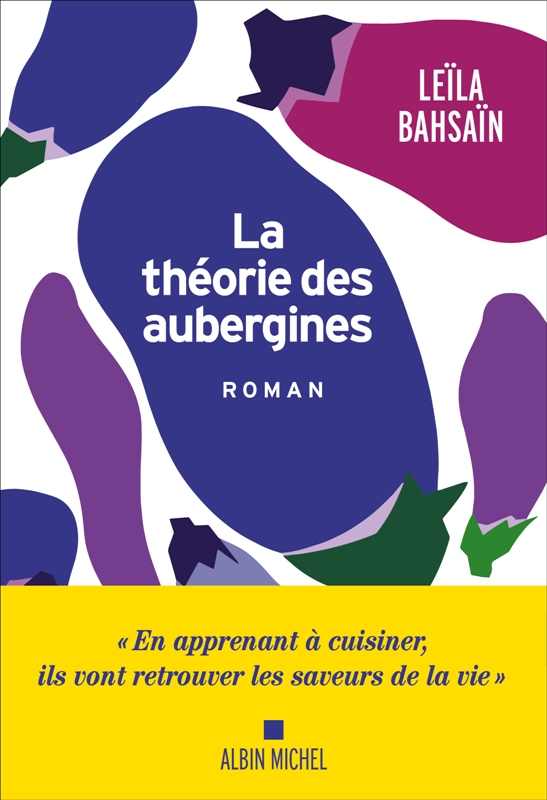Alain Bittar, directeur de l’ICAM, a accueilli virtuellement Leïla Bahsaïn qui présente son nouveau roman, La Théorie des aubergines
En 1979, Alain Bittar crée la Librairie arabe L’Olivier qui continue depuis quatre décennies à établir un trait d’union entre la Suisse et le Monde arabe. La librairie regroupe le livre, la musique ainsi qu’une Galerie d’Art spécialisée dans l’Art contemporain mais L’ICAM – L’Institut des cultures arabes et méditerranéennes – organise aussi l’accueil de concerts, de rencontres littéraires, en présence, bien évidemment en temps normal. Mi-avril 2021, l’ICAM a organisé une rencontre virtuelle avec Leïla Bahsaïn, disponible pour présenter son second roman, La Théorie des aubergines aux éditions Albin Michel.
Leïla Bahsaïn, auteure franco-marocaine, vit à Besançon. Après avoir été conseillère en réinsertion, elle s’occupe désormais d’une association, Zitoun (olive, en arabe; N.D.L.R.) qu’elle a fondée au Maroc, qui se consacre à l’alphabétisation des femmes. Leïla Bahsaïn a publié deux nouvelles dans la revue Apulée, puis des nouvelles dans le Magazine littéraire du Maroc. Elle a reçu le Prix de la Nouvelle de Tanger, décerné par l’institut français de Tanger et la Bibliothèque nationale du Royaume. Elle a publié son premier roman chez Albin Michel, Le Ciel sous nos pas, Prix Méditerranée du premier roman 2019, qui a été en lice pour le Prix France-Télévision, le Prix Cazes et le Prix de la Littérature arabe. Dans ce premier roman, inspiré de son parcours, plein d’énergie aux allures de conte moderne, Leila Bahsaïn évoque dans une langue sensuelle, insolente et métissée, le parcours d’une jeune Marocaine, depuis son enfance dans son pays natal à son arrivée en France. « Décomplexée vis- à-vis des hommes et de l’Occident, elle va vivre mille aventures, telle une Zazie moderne, entre rires et larmes ! Et briser un tabou : le pays des Lumières n’est pas la partie rêvée des droits de la femme maghrébine », comme le mentionne son éditeur. Invitée virtuellement vu le contexte actuel par l’ICAM, Leïla Bahsaïn nous parle de son deuxième roman, La Théorie des aubergines.
Lorsque sa protagoniste perd son poste de rédactrice dans une agence de publicité, Dija se voit proposer de rejoindre une entreprise d’insertion par la cuisine. L’atmosphère est chaleureuse et sympathique, les effluves délicieuse et les participants à cet atelier bigarrés : il y a Véronique, l’infirmière en burn-out; Jean, le grand timide; Gérald, un repris de justice à la petite semaine; Johnny-Bryan, un altruiste opposé à l’idée même de travail … D’autres personnages, tout aussi attachants et hauts en couleur, les rejoindront. Sous la houlette optimiste du chef Achour, convaincu des bienfaits de l’esprit collectif et de l’entraide, cette jolie assemblée d’âmes brisées va apprendre à s’apprivoiser en se réconciliant avec les saveurs de la vie.
Leïla Bahsaïn s’inspire de son propre vécu et croque avec beaucoup de lucidité, de bienveillance, saupoudrant de sa verve caustique, une palette touchante de personnes meurtries par les épreuves de la vie. Son roman savoureux, sa narratrice affable et bouillonnante d’idées sur l’art de se réinventer, ses participants et leurs particularités se mélangent ; le résultat qui sort de ce creuset s’apparente à une « Comédie humaine » contemporaine. Le nouveau roman de Leïla Bahsaïn invite les lectrices et les lecteurs à un jeu savoureux entre la théorie d’une part et les aubergines d’autre part, distillant quelques conseils pour se remettre sur les rails de la vie, se réinsérer par le truchement thérapeutique de l’art culinaire, un baume pour l’âme et le cœur et un régal pour les papilles. Le roman, porté par le chef qui apprend à ces personnes à cuisiner tout en (ré)apprenant à se faire confiance, regorge de poésie et d’humour pour nous présenter ces portraits de personnes touchés par la vie et dont les meurtrissures restent palpables.
Ce second roman convoque la cuisine, les épices pour panser les blessures de l’héroïne qui choisit de retourner au Maroc; comment est-il né dans votre imagination ?
Je ne choisis pas tout dans ma facon d’écrire mais je choisis de mettre beaucoup d’humour, d’ironie dans mon écriture. Quand on écrit, c’est notre vision de monde qui ressort même si ce n’est pas toujours conscient. Face à des sujets très sérieux, l’humour et l’ironie peuvent être une façon de s’en sortir, une arme face aux épreuves.
Pourquoi avoir choisi un atelier de cuisine ? Pour permettre à ces personnes de se rencontrer, au sens propre et au sens figuré ?
La cuisine est importante pour moi. J’aurais pu réunir ces personnes dans un atelier de couture. Dans une cuisine, on se nourrit, on pourrit l’autre, on met les pieds dans le plat. La cuisine est un lieu apprécié par rapport à un atelier de réinsertion. Beaucoup d’écrivains se sont inspirés de la cuisine pour faire les beaux textes de la littérature.
Parlez-nous de vos personnages …
Mon point de départ résulte toujours des personnages. Cela correspond à une expérience que j’ai connue comme conseillère en réinsertion. Un personnage n’est pas fait d’un seul bloc. Un personnage peut être à la fois attendrissant, agaçant; un personnage a plusieurs facettes parfois déconcertantes. Quand je recevais des personnes en réinsertion, quand je les accompagnais, à la fin de ma journée, je me rendais compte qu’ils étaient beaucoup plus que ce que montraient leurs parcours et leur personnalité. Pour la plupart, ils avaient connu des jours meilleurs et ils se retrouvés méprisés socialement. Le mépris social est important dans ce livre, y compris pour la narratrice. Ces personnages ont en commun des fêlures qu’ils ont connues et qui vont les rapprocher.
Votre second roman présente une critique acerbe du métier de communicants ?
Effectivement, c’est une critique sociale. Certaines entreprises axent tout sur une performance sans limites. La narratrice était rédactrice « à l’ancienne ». Petit à petit, elle se rend qu’elle a dû mal à s’adapter au mutations, en particulier elle ne se fait pas à la paupérisation du langage et aux contrainte digitales. De nos jours, on a l’impression d’ouvrit des espaces de narration via les réseaux mais en réalité il y a une paupérisation langagière.
Ces divers personnages qui, apparemment ne partagent rien, vont petit à petit apprendre à se connaître. Vous faites un flashback sur leur vie et, par ce biais vous permettez aux lectrices et aux lecteurs d’apprendre à les connaître …
Ces personnes arrivent à cet atelier contraints et forcés. Au début de cet atelier, ils se regardent en chiens de faïence. Au départ, les rapports ne sont pas simples : il y a des jérémiades, des crêpages de chignons, des conflits sociaux. Puis naît une solidarité mais aussi une cassure : deux personnes quittent la cuisine. Mais la cuisine rassemble, nous rapproche sur les similitudes plutôt que sur ce qui nous différencie, la cuisine lie ce qui fait l’autre. Dans notre société, il existe un réel engouement pour la cuisine avec un grand chef ou un dîner avec des personnes inconnues.
Avec les repas tout prêts proposés par l’industrie agro-alimentaire, notre société avait-elle perdu le sens convivial de partage qu’offre la cuisine ?
On a besoin de donner du sens à notre vie et aux échanges avec les autres. Le mot « cuisine » a deux définitions : d’une part, quand on prépare à manger, la cuisine fait appel à tous nos sens. Ce n’est pas un hasard si on se fait beaucoup d’émissions sur l’art culinaire, on est en quête de sens et la cuisine donne un sens double. Avec la cuisine, la mixité est valorisée : il s’agit de bien manger. Avant, c’était anodin et cantonné à l’univers des femmes alors qu’aujourd’hui, on met en avant des hommes, des femmes : cuisiner est devenu valorisant.
La cuisine joue-t-elle un rôle ethnologique et anthropologique ?
La cuisine touche aux questions de genres, de la mondialisation. La cuisine joue beaucoup sur notre façon de nous nourrir :on est très ouvert sur les questions du monde. il y a des personnages qui illustrent ces sujets dans le roman. Par exemple, quand les personnages doivent préparer un repas pour un haut fonctionnaire, ils préparent une entrée asiatique, un repas africain et un tajine; cette variété venue d’horizons culturels et géographiques différents illustre notre rapport au monde. Si seulement on acceptait dans nos rapports quotidiens un mélange comme dans la cuisine ! De plus en plus, la cuisine est questionnée comme étendard pour valoriser les cultures : découvrit des aliments d’autre sprays dans les supermarchés où se côtoient des sauces chinoises, un guacamole, des sushis et un Colombo de poulet offre une ouverture extraordinaire. Mais il ne faut surtout pas rester coincé à cet aspect marchand des autre pays : dans le roman, tout le monde attend d’Ishtar, qui est syrienne, qu’elle fasse des falafels et des plats du Moyen-Orient. Chacun a des fantasmes.
Leïla Bahsaïn, vous avez une double appartenance tant culturelle que gastronomique entre la France et le Maroc; comment vous cette double appartenance ?
Je vis bien cette double appartenance, comme une grande richesse. Je profite de mes deux cultures, même au-delà ! Ma narratrice a des comptes à régler car elle n’est pas rentrée dans son pays depuis son arrivée en France. J’ai deux cultures et deux gastronomies très riches et je les vis au quotient : par exemple, je mets de la rhubarbe, qu’on ne connaît pas du tout au Maghreb, dans un tajine; le résultat est très réussi, très beau. Dans le roman, la cuisine sert de lien à Dija avec un pays, sa mère qu’elle ne voit pas. Cela s’assimile à Proust et à sa Madeleine (rires).
Votre roman contient à la fois de l’humour mais aussi beaucoup de poésie ?
Dija a une vision poétique sur le monde, elle simplifie les rapports entre les gens grâce à sa cuisine. Elle revient sur les vraies valeurs sur l’essentiel, elle se questionnait beaucoup dans cet emploi – cadre – même si cela lui amenait une réussite sociale de façade. Elle se retrouve chômage, elle était en quête de sens, elle avait des ambitions artistiques : elle voulait être poétesse et se contentait d’écrire des brochures touristiques. Quand on lui propose cet atelier de cuisine à animer, elle pense prendre ses jambes à son cou mais, elle trouve progressivement du sens à sa vie et se réjouit de liens simples.
Comment est née votre passion pour l’écriture ?
Enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais que je voulais être écrivaine mais écrivain n’était pas considéré comme un métier. Dans les années 80 au Maroc, il n’y avait pas beaucoup de lieux d’accès aux livres. J’ai fait des études comme scientifiques et des études de commerce. A l’Ecole de commerce, j’ai obtenu un master en management. Je ne me suis jamais éloignée de l’écriture. Je suivais les cours en arabe et le français comme première langue étrangère. J’ai toujours lu t écrit, puis j’ai commencé à écrire à des revues qui ont publié mes écrits. Beaucoup de jeunes femmes se lancent dans l’écriture et rencontrent un succès phénoménal. Je pense à Virginia Woolf; l’écriture n’a pas de sexe. Quand on décide de s’engager dans cette voie, il ne faut pas s’autocensurer. Quand on écrit, il faut être capable de faire preuve d’empathie avec un personnage masculin ou féminin, un objet. Grâce à celles qui m’ont précédé, j’ai plus de liberté. Quand on décide d’écrire, il faut être sincère et honnête. L’écriture est un espace de liberté et un espace de sincérité. Il faut avoir l’audace de la sincérité et non l’audace de la provocation, il ne faut pas chercher à faire sensation mais livrer une pensée brute qui soit à l’état pur.
Comment voyez-vous le rapport hommes-femmes ?
Le rapport hommes-femmes doit être un rapport amoureux, humain, un rapport de fraternité et de complémentarité au-delà du sexe. La question du mépris, c’est le grand drame de part et d’autre. Je suis pour un rapport égal : l’aspect des droits, des salaires, des statuts administratifs. Je ne vois pas pourquoi j’hériterai moins que mon frère ou que je toucherai un salaire moindre qu’un homme en tant que femme. La réalité au Maroc est que les femmes portent les familles, pas seulement dans les grandes villes. La solution réside dans l’alpabétisation et l’éducation. C’est pourquoi en 2009, j’ai créé au Maroc une association, Zitoun, qui se consacre à l’alphabétisation des femmes. Souvent, les femmes cumulent les rôles : elles gèrent la famille, elles contribuent aux dépenses de la famille. Il s’agit d’une initiative privée soutenue par le gouvernement. Au départ, c’était une initiative personnelle, avec des moyens modestes. Dès la troisième année, on a obtenu des financements publics. L’Etat a très bien compris qu’il fallait soutenir les associations, surtout en milieu rural.
Quelle place occupe le religieux dans les sociétés arabes?
C’est un sujet important qui ressort dans mon roman. En France, on suppose que Dija est musulmane. Elle résiste à cela. On ne fait pas forcément de sa religion un étendard que l’on va brandir partout et qui sert à rejeter cela. Dans un restaurant, on suppose quelle mange que halal donc on lui sert du poisson. Dans certains pays d’Europe, comme elle est typée, les gens décident pour elle et se disent « Donnons-lui du poisson ! » au lieu de lui donner une carte pour qu’elle choisisse. Le religieux est réducteur dans une religion qui emprisonne, dans la religion qui souhaiterait dicter la conduite. Ce serait mieux de faire comprendre les religions, l’aspect spirituel. Ce qui choque mes personnages, c’est que dans les sociétés modernes, on traite avec Dieu comme avec un comptable, dans un rapport marchand : « Je te donne tel acte et tu me donnes cela ! » Dans la langue arabe, on parle d’un des cinq piliers de l’Islam, la Zakât, l’aumône. Dans mon roman, Ishtar va servir des repas à des gens qui travaillent dans cette agence. Son téléphone sonne avec une chanson en arabe et les gens qu’elle sert sont tous terrorisés. Que « Allahou akbar» fasse peur aux gens, c’est triste ! Il ne faut pas stigmatiser une langue et faire un amalgame.
Vu les mesures sanitaires actuelles, vous ne pouvez malheureusement pas rencontrer votre lectorat ; comment le vivez-vous ?
C’est important de garder le lien et c’est un des bienfaits des réseaux sociaux. C’est vraiment regrettable et triste de ne pas pouvoir rencontrer les lecteurs et discuter dans des salons comme auparavant. j’espère que cela va revenir prochainement.
Propos recueillis lors de la rencontre virtuelle avec Leila Bahsain-Monnier, rencontre organisée par l’ICAM, à Genève.
Firouz E. Pillet
© j:mag Tous droits réservés